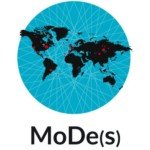Symposium
Esthétiques de la résistance : d'autres voyages pour la vie

Partant du voyage pour la vie des Zapatistes en Europe en 2021, ce symposium cherchera à analyser le rôle structurant des images dans la constitution de modèles de résistance aux logiques extractivistes et néolibérales, afin de créer des espaces de solidarité et de partage. Les pratiques de marronnage, les systèmes d'autogestion des femmes et les modèles de buen gobierno indigènes seront évoqués à travers leurs cultures d'images et leurs pratiques collectives afin de penser différentes propositions d'organisation alternative pour la survivance du vivant, depuis le Sud Global, pour reprendre une expression d’usage.
Les postulats « des voyages pour la vie », dont on veut analyser les motivations, résonnent avec le renversement philosophique et anthropologique qui a eu lieu dans les dernières décennies du XXe siècle (Latour, 1991 ; Haraway, 1991) et les demandes des mouvements (éco)féministes et écologiques (Hache, 2016 ; Malm, 2021). En résonance avec les zapatistes et la pensée des communautés autochtones (indígenas, en espagnol), le renouvellement de la manière occidentale de percevoir le commun convoque la remise en question d’un postulat hégémonique en économie, exclusivement anthropocentré. Les analyses d’Haraway postulent que la survie face à l’effondrement écologique de la Terre passe non seulement par la communauté humaine, mais aussi par la coopération inter-espèce et la mise en place d’un commun du vivant (2020). À ces formes s’arriment des pratiques culturelles et visuelles spécifiques (Mirzoeff, 2020) déterminantes pour le partage et la construction du social, que ce symposium veut soumettre à la réflexion aussi bien de chercheurs et chercheuses que d’artistes.
La journée est retransmise en direct sur la chaîne YouTube des Abattoirs :
https://www.youtube.com/live/ZsfKpIWvx1E?feature=shared
Le programme
Matin
10.00-10.15 Introduction d'accueil avec Lauriane Gricourt (Directrice des Abattoirs Musée - Frac Occitanie Toulouse) ; Paula Barreiro López (Université Toulouse Jean Jaurès) et Sonia Kerfa (Université Grenoble Alpes)
10.15-10.30 Paula Barreiro López (Université Toulouse Jean Jaurès) et Sonia Kerfa (Université Grenoble Alpes) , Nouveaux mondes à construire: aborder la culture visuelle du voyage des zapatistes pour la vie en Europe
10.30-11.45: Lorena Tabares (commissaire d’expositions), Un océan où des nombreux océans s’intègrent. Inversions et poétiques océaniques de l'escadron zapatiste 421 dans la Montaña (en espagnol avec traduction par Cristina García Martínez) en conversation avec avec Anita Orzes (Université de Barcelone)
11.45-12.45 Francesca Cozzolino (EnsAD, Paris), Agir par l’art : solidariser, politiser, résister. Des exemples issus du voyage pour la vie zapatiste, en conversation Tobias Locker (Saint Louis University Madrid)
Après-midi
14.30- 15.30 Zahia Rahmani (Institut National d’Histoire de l’Art) : Le voyage de l’Eucalyptus : De la Mer de Tasmanie à la désertification des sols en terre africaine - Suivi du récit de quelques initiatives de refondation agricole contre l’assèchement des sols en Afrique du Nord en conversation avec Evelyne Toussaint (Université Toulouse Jean Jaurès)
15.30-16.30 Olivier Marboeuf (artiste): Tapisseries cacophoniques et cinéma déparlant : tentatives pour une archive fugitive de la Caraïbe en conversation avec Lauriane Gricourt (Abattoirs)
16.30-16.50 Pause
16.50- 17.30 Les femmes de X’oyep (2024) présentation du livre d' Alberto del Castillo avec Marion Gautreau (Université Toulouse Jean Jaurès) et Audrey Leblanc (EHESS)
17.30-18.15 Table ronde avec l'ensemble de participant.es et le public modéré par Julia Ramírez Blanco (Universidad Complutense de Madrid)
18.15-18.30 Clôture
Les intervenants
Paula Barreiro López est professeure d’histoire de l’art contemporain à l’Université Toulouse II Jean-Jaurès et membre du laboratoire FRAMESPA (France, Amériques, Espagne — Sociétés, pouvoirs, acteurs). Sa carrière professionnelle s’est développée dans diverses institutions européennes en Espagne, Angleterre et en France. À travers ses nombreuses initiatives scientifiques, parmi lesquelles compte notamment la création en 2015 de la plateforme de recherche internationale MoDe(s) — Modernité(s) Décentralisée(s), réunissant des chercheurs de différents centres en Europe, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord qui travaillent sur le thème « Art, politique et contre-culture dans l’axe transatlantique de la guerre froide au monde contemporain », elle contribue à une histoire de l’art contemporain en cours de mondialisation. Elle est autrice du livre Compagnons de lutte. Avant-garde et critique d’art en Espagne pendant le franquisme (Paris, Éditions de la MSH, 2023) qui a reçu le Prix Pierre Daix 2023 de la Fondation Pinault pour l’Art Contemporain. Actuellement, elle mène avec Sonia Kerfa un projet pluridisciplinaire sur le Voyage des Zapatistes en Europe avec le soutien du Labex SMS de l’université Toulouse Jean-Jaurès.
Francesca Cozzolino est anthropologue et docteure de l’EHESS (2010). Elle enseigne les sciences humaines et sociales à l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs (EnsAD), PSL Research University, Paris. En 2023-2024, Cozzolino a été membre scientifique de la Casa de Velázquez à Madrid. Elle mène ses recherches à EnsadLab et est affiliée au LESC-CNRS (Université Paris Nanterre) ainsi qu’au CEMCA (Mexico). Spécialiste de l’ethnographie des pratiques artistiques, elle travaille à l’intersection de l’anthropologie de l’art et de la culture matérielle. Son approche propose une anthropologie politique de l’art, analysant comment les formes artistiques et les discours sur la création nourrissent une pensée politique. Elle s’intéresse particulièrement aux contextes postcoloniaux. Depuis 2017, Cozzolino mène une enquête au Mexique sur les résistances artistiques et les échanges entre le Mexique et l’Europe. Son travail explore comment ces dynamiques influencent la réécriture de l’histoire.
Marion Gautreau est maîtresse de conférences au département d’études hispaniques et hispano-américaines de l’Université Toulouse II Jean-Jaurès et membre du laboratoire FRAMESPA (France, Amériques, Espagne — Sociétés, pouvoirs, acteurs), au sein duquel elle développe ses recherches sur l’histoire de la photographie latino-américaine et, plus particulièrement, mexicaine. De 2016 à 2018, elle a coordonné un projet PICS sur Photojournalisme et photographie documentaire au Mexique depuis 1968. Avec Jean Kempf (Université Lyon 2), elle a co-édité le numéro 13 de la revue IdeAs sur La photographie documentaire contemporaine dans les Amériques (2019). Elle a publié en 2017 l’ouvrage De la crónica al icono. La fotografía de la Revolución mexicana en la prensa ilustrada capitalina (1910-1940). Ses recherches sur le champ photographique latino-américain ont été publiées, entre autres, dans les revues Alquimia, Historias (Mexique) Archivos de la Filmoteca (Espagne), Caravelle, Cahiers ALHIM (France). De 2019 à 2023, elle a également été vice-présidente déléguée à la culture de l’Université Toulouse II Jean-Jaurès.
Sonia Kerfa est professeure des Universités (Université de Grenoble Alpes), agrégée d’espagnol. Directrice du Centre de Recherche des Hispanistes du laboratoire ILCEA4. Ses travaux de recherche s’intéressent aux arts visuels dans le monde hispanique et à l’histoire et à l’esthétique des cinémas du réel, dans une perspective genrée. Elle a publié Le geste documentaire des réalisatrices. Amérique latine-Espagne, 2023, avec D. Marchiori et A. Mateus ; «I’m Not Your (Dead) Latina». Ana Mendieta. Reminiscencias políticas y estéticas. Monograma. 2022 avec I. Castro; "Latin American feminist film and visual art collectives", Jump Cut: a review of contemporary media, n° 61, Fall 2022, avec L.Cervera et E. Ramírez-Soto. Son projet sur la photographe féministe Franca Donda (Venezuela) a été soutenu par le GIS-Institut du Genre. Actuellement, elle mène avec Paula Barreiro Lopez un projet pluridisciplinaire sur le Voyage des Zapatistes en Europe avec le soutien du Labex SMS de l’université Toulouse Jean-Jaurès.
Audrey Leblanc est historienne de la photographie, chercheuse associée à l’EHESS, Paris. Elle est Visiting Researcher 2025 de Archivo, Photography and Visual Culture Research Platform. Ses recherches explorent l’histoire culturelle des producteurs d’images des années 1960 aux années 1990, selon une perspective archivistique et comparatiste. Elle vient de publier à ce sujet, « De quelle(s) histoire(s) les photographies d’agence sont-elles l’archive ? La collection Black Star à l’Image Centre de la Toronto Metropolitan University » (20&21. Revue d’histoire, no 163).
Tobias Locker est enseignant-chercheur à l’University Saint Louis Madrid. Il a obtenu son doctorat en histoire de l’art à l’Université Technique de Berlin en 2011. Ses recherches actuelles portent sur l’étude de la matérialité des objets d’art et leur connexion aux aspects décoloniales et écologiques de l’époque moderne et leurs reflets dans la production artistique contemporaine. Il a publié sur l’instrumentalisation de l’art dans le contexte des expositions universelles ainsi que de la première période du Francoisme. Il a été chercheur invité au Bard Graduate Center à New York, au Instituto de Historia del Arte Argentino y Americano (IHAAA) à l’Universidad Nacional de La Plata en Argentine et au Deutsche Forum für Kunstgeschichte à Paris.
Olivier Marbouef est auteur-conteur, artiste, commissaire d’exposition indépendant, théoricien de la culture et producteur de cinéma, originaire de Guadeloupe. Il a fondé avec l’auteur franco-béninois Yvan Alagbé au début des années 1990 les éditions Amok (devenues Frémok), éditeur de bande dessinée de recherche à l’origine du légendaire café littéraire parisien Autarcic Comix. Il est ensuite devenu directeur artistique de l’Espace Khiasma (2004 à 2018), centre d’art visuel et de littérature vivante basé en proche banlieue de Paris et dédié aux représentations minoritaires, contribuant à introduire les théories postcoloniales sur la scène artistique française à partir de nombreuses expositions et rencontres. Il est notamment membre fondateur du Réseau Indépendant des Travailleur·euses et Acteur·ices de l’Art (RITAA) en Guadeloupe, de RAYO, programme de pédagogie expérimentale dans la Grande Caraïbe ainsi que du board international de l’Akademie der Künste der Welt de Cologne.
Anita Orzes est docteure en Histoire de l’Art par l’Universitat de Barcelona et l’Université Grenoble Alpes. Ses recherches portent sur la transformation du modèle des biennales et les réseaux transnationaux entre biennales en Amérique latine et en Europe pendant la Guerre froide. Elle a réalisé des séjours de recherche à l’Académie de France à Rome – Villa Médicis (2023), à Goldsmiths, University of London (2022), à l’Universidade Federal de São Paulo (2022) et à l’Université de La Havane (2019). Elle a participé aux jueves de la Bienal de la 15ᵉ Biennale de La Havane (2024-2025) et à l’Événement Théorique de la 14ᵉ Biennale de La Havane (2021-2022). Elle a travaillé comme médiatrice culturelle à la 53ᵉ Biennale de Venise (2009) et comme documentaliste pour l’exposition Caso de estudio. España. Vanguardia artística y realidad social: 1936-1976 (Institut Valencià d’Art Modern, 2018-2019), portant sur la participation de l’Espagne à la 37ᵉ Biennale de Venise.
Zahia Rahmani est écrivaine, historienne d’art et commissaire d’exposition. Elle est directrice du programme “Histoire de l’art mondialisée” à l’Institut National d’Histoire de l’Art (INHA) à Paris. Inauguré en 2004, il est le premier domaine de recherche dédié aux corpus critiques et aux pratiques artistiques à l’ère de la mondialisation. Elle a travaillé à la Villa Arson (École nationale d'art de Nice), à la Galerie nationale du Jeu de Paume à Paris et à la Leo Castelli Gallery à New York. Elle a été commissaire de l’exposition Made in Algeria: Généalogie d’un territoire au Mucem de Marseille en 2016 et a dirigé le projet de recherche Sismographie des luttes, consacré aux revues culturelles et critiques non européennes. Rahmani est l’autrice de Moze (2003), Musulman Roman (2005) et France, récit d’une enfance (2006). De 1999 à 2003, elle a créé et dirigé le Research Program, post-diplôme de l’École nationale supérieure des Beaux-arts de Paris, sous la direction d’Alfred Pacquement. Rahmani est membre du Collège de la Diversité et Chevalier des Arts et Lettres.
Julia Ramírez-Blanco est chercheuse (contrat d’excellence Ramón y Cajal) à l’université Complutense de Madrid. Son travail interdisciplinaire relie l’histoire de l’art, les études utopiques et les mouvements activistes. Elle a étudié l’iconographie politique des mouvements sociaux, notamment l’écologisme britannique d’action directe des années 1990 et le mouvement espagnol 15M. Elle s’intéresse aussi aux liens entre art contemporain et utopie, ainsi qu’à l’histoire genrée des collectifs artistiques. Ramírez-Blanco est l’autrice de Artistic Utopias of Revolt (2018), 15M. El tiempo de las plazas (2021), Amigos, disfraces y comunas (2022) et La ciudad del Sol (2023). Elle a codirigé l’exposition Grande Révolution Domestique-Guise sur les utopies féministes. Elle travaille actuellement sur les utopies écologiques face à la crise climatique.
Lorena Tabares Salamanca est chercheuse, écrivaine et curatrice indépendante, spécialisée dans l’art contemporain, les archives et la performance. En 2023, elle a obtenu un master en Sciences de la Communication et des Arts à l’Université Nova de Lisbonne, avec un mémoire portant sur les reenactments et les poétiques du Mouvement Zapatiste dans son Voyage pour la Vie (2021). Elle a été commissaire d’expositions pour divers espaces au Mexique, au Portugal et en Autriche, et à collaborer avec l'Institut de la Culture du Mexique à Vienne, l’Atelier Artéria, le Centre scientifique et culturel de Macao à Lisbonne ainsi que le festival WienWoche. Elle a été commissaire en résidence en Serbie, au Festival Video-Park à Užice, et en Italie dans le cadre du programme Neither on Land nor at Sea de la Cittadellarte – Fondazione Pistoletto. En 2019, elle a coédité le 15e numéro de la revue Terremoto. Elle a mené la recherche et la coordination du programme éducatif Performance en révision 1990-2019 à Mexico. En 2017, elle a fait partie de l’équipe d’Ex Teresa Arte Actual pour le projet Stabilisation, description et numérisation des documents audiovisuels et photographiques sur formats analogiques du Fonds Ex Teresa (1993-2000).
Organisation: Paula Barreiro López (Université Toulouse Jean Jaurès), Lauriane Gricourt (Les Abattoirs, Musée - Frac Occitanie Toulouse) et Sonia Kerfa (Université Grenoble Alpes)
Symposium organisé dans le cadre du projet Images politiques et nouveaux mondes à construire : la culture visuelle du voyage des zapatistes pour la vie en Europe / NOVA-IMAGO-ZAP du Labex SMS et de la plateforme internationale de recherche Modernités Décentralisés avec le soutien du FRAMESPA, du ILCEA 4 et des Abattoirs, Musée - Frac Occitanie Toulouse.